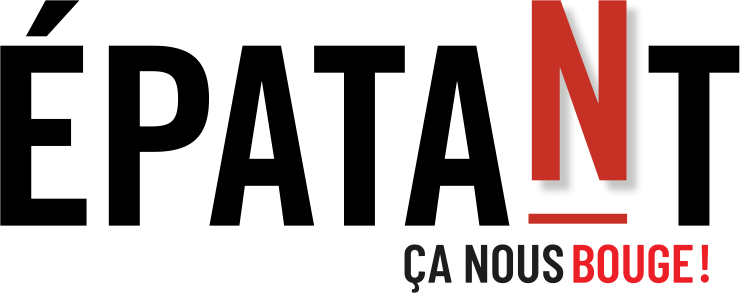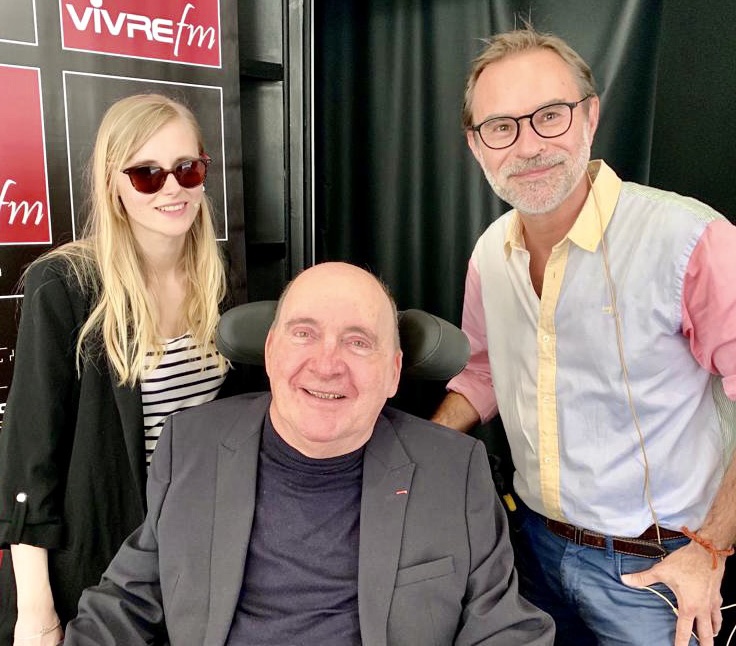Politologue, sondeur et surtout fin connaisseur des arcanes du pouvoir, Roland Cayrol a traversé un demi-siècle de vie politique française avec une rare clairvoyance. S’il a toujours refusé de se livrer à l’exercice de l’autobiographie, il a finalement accepté de partager son expérience d’un demi-siècle au contact de tous les personnages qui ont façonné notre histoire récente dans « Mon voyage au cœur de la Ve République ». Rencontre passionnante entre nostalgie et bon sens tourné vers l’avenir.
EP – Vous avez toujours été réticent à l’idée d’écrire vos mémoires. Pourquoi avoir changé d’avis ?
RC – Tout au long de mon existence, j’ai été témoin de pas mal d’événements… Souvent dans des conditions de discrétion, parfois même de secret. En fin de parcours, il me semble que le moment est peut-être venu de transmettre, de partager un peu de ce parcours, à la fois sur le ton de l’anecdote et de l’analyse. Avec mon ami, Arnaud Mercier (professeur à l’Institut français de presse, université Paris Panthéon Assas NDRL), nous avons donc commencé par une série d’entretiens, mais en décidant dès le début que ce ne serait pas un livre d’entretiens ! Arnaud a été un vrai challenger, il m’a poussé, parfois, à en dire un peu plus que ce que j’aurais souhaité. Mais à la fin, c’est bien moi qui ai entièrement réécrit ce texte. Et qui en porte l’entière responsabilité.
EP – En matière de politique, l’actualité fait écho à l’histoire sur un point central : l’hyper présidentialisation. Ne rejoint-elle pas ce que Pierre Mendès France craignait avec l’instauration du suffrage universel direct ?
RC – D’abord, l’hyper présidentialisation n’est pas une nouveauté. Le général de Gaulle n’était pas homme à donner carte blanche à son Premier ministre ! Au contraire, il répétait sans cesse : « Le Président de la République est la clé de voûte des institutions ». Il l’explique dès 1946 dans un discours, à Bayeux, où il décide ce que devrait être la constitution de la France. On en retrouve ensuite l’essence dans le texte de la Constitution de 1958. Après lui, président après président, ce phénomène de présidentialisation s’est accentué, avec une tendance, parallèle, à la personnalisation du pouvoir. Est-ce dû au seul système présidentiel ? Pas certain. Il me semble que c’est un fait commun à beaucoup de démocraties modernes, et même à beaucoup de démocraties parlementaires. Regardez en Grande-Bretagne, pourtant « mère du suffrage majoritaire » : la campagne y est également très personnalisée. Regardez aussi en Italie, en Allemagne, en Suède… Partout on observe ce même mouvement.
Pour moi, cela touche surtout plus largement à une forme de relation entre le pouvoir et l’opinion, que ce soit à travers les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. Il y a cette demande de personnalisation, de responsabilité du « chef ». Et voilà pourquoi l’élection de ce « chef » a un côté presque sacré, ce qui n’est pas forcément le cas des autres scrutins. Quand vous interrogez aujourd’hui les Français sur leurs institutions, ils sont d’abord agacés. Les débats institutionnels ? Ils s’en fichent. Il n’y a que deux points qui les intéressent. Premièrement : conserver l’élection présidentielle au suffrage universel. Parce qu’ils ont le sentiment que ce choix-là (« leur » choix) est un choix « arraché » aux politiques. Deuxièmement, ils veulent toujours renforcer les pouvoirs du Parlement. Tout le reste, je le redis, ils s’en fichent !
EP – Cette personnalisation de l’homme ou de la femme politique n’est elle pas un facteur de désertion pour les électeurs, notamment chez les jeunes?
RC – Je crois au contraire que cela donne « chair » à la politique. Je ne trouve pas que nous soyons tombés dans le sentimentalisme ou l’émotion personnelle à l’excès. Bien sûr, les candidats ne nous épargnent pas la communication autour de leur famille ou de la naissance de leurs enfants, mais nous sommes encore loin d’une élection à l’américaine, par exemple. Chez nous, il y a encore une espèce de forme de respect pour la politique qui nous empêche de tomber dans les pires excès.Quant aux jeunes, c’est la politique elle-même qu’ils ont prise en détestation. Ils ont perdu confiance, comme ils ont perdu confiance dans beaucoup d’institutions. C’est vrai qu’ils s’abstiennent plus que les autres à la présidentielle, mais moins que dans d’autres élections. Quand les Français s’abstiennent à 50 % dans une législative, ce qui est déjà ahurissant, les jeunes de moins de 25 ans sont 80 % à ne pas se déplacer !
EP – Quelles sont les pistes envisageables pour relancer l’intérêt de ce public là envers la vie démocratique ?
RC – Tout d’abord le fond des dossiers. Quand on parle de politique, il faut montrer le lien entre ce que l’on raconte et la réalité. Les gens se méfient de plus en plus des mots qui se terminent en « isme ». On ne croit plus aux idéologies globalisantes, aux lendemains qui chantent, au bonheur qui est dans le pré… En 1974, le mot d’ordre de Mitterrand c’était « Changer la vie ». On ne peut plus dire ce genre de choses. Il faut rendre la politique concrète, avec des mesures qui ont un vrai sens pour la vie des gens. Je crois que c’est particulièrement vrai pour les jeunes qui pensent que la politique est une bulle de gens qui font leur carrière, se moquent complètement de leurs attentes, de leurs besoins et même de leurs reproches. La deuxième chose, c’est de permettre aux citoyens de participer. Aujourd’hui, nous sommes, particulièrement aux yeux des jeunes, dans une démocratie représentative qui ne nous représente pas du tout ou mal. Or, partout ailleurs, comme parent d’élève, comme salarié, comme membre d’association, chacun a pris l’habitude de pouvoir dire son mot, d’avoir une influence sur les décisions qui sont prises.
Plus que jamais, la politique apparaît donc comme cette espèce de « machin » au-dessus de la société, auquel le citoyen de base n’a pas vraiment accès. Résultat, les citoyens réclament plus de participation directe, ce qui va de pouvoir répondre aux sondages jusqu’à organiser des référendums, des conventions citoyennes, des comités de quartiers etc. Je crois moi aussi – et c’est la deuxième clé- qu’il faut relayer la démocratie représentative par une démocratie plus participative. Mais ici, même les politiques qui manifestement leur intérêt en théorie, ont toujours des réticences en pratique. Dernier point : il faudrait organiser les conditions techniques d’une meilleure participation, y compris aux élections. Il y a aujourd’hui 7 millions de non-inscrits en France. C’est ahurissant. Pourquoi ne sommes nous pas tous inscrits sur une liste électorale ? Les jeunes sont automatiquement inscrits à 18 ans. À cet âge-là, en général, ils vivent chez leurs parents. Mais au moment de leur premier vote, ils ne vivent généralement plus chez leurs parents et donc ils ne sont pas inscrits dans la commune où ils travaillent, où ils étudient. Ils doivent faire la démarche mais ils ne savent même pas laquelle. On pourrait éventuellement voter avec uniquement sa carte d’identité. Pourquoi continuer à demander une carte électorale ? Vous voyez, il y a un tas de mesures techniques que l’on pourrait prendre parce qu’il est absolument inadmissible qu’une partie extrêmement importante des Français et des jeunes en particulier ne soient même pas considérés comme inscrits sur les listes électorales.
EP – Vous avez soutenu notre magazine, Épatant, pour tester une nouvelle façon de voter, qui ne distribuerait pas une seule voix, mais plusieurs, en fonction de ses préférences et de ses rejets. Quels enseignements peut-on retirer de cette expérimentation, et jusqu’à quel point le système français est-il perméable à ce genre d’innovations?
RC – Commençons par la fin. Le système électoral français n’est absolument pas perméable aux changements. Ensuite, lorsqu’on vote, on prend en compte plusieurs facteurs. On vote dans un champ concurrentiel, donc on vote pour son candidat préféré. Deuxièmement, on vote pour son candidat préféré, surtout s’il a une chance de se qualifier pour le second tour. Il y a donc un arbitrage à faire avec le candidat que vous aimez peut-être « un peu plus », mais qui n’a pas forcément une chance de passer… L’idée de ce sondage, c’était justement de montrer qui bénéficiait d’un « rapport qualité-prix » (rire). On ajoutait donc des points lorsqu’on votait « pour » un candidat et on en retirait lorsqu’on votait « contre ». Cela se traduisait par un nouveau paysage dans lequel les extrêmes étaient forcément un peu diminués. Et les vrais arbitres étaient les candidats du centre gauche ou du centre droit. Je crois que ce résultat dit quelque chose de la réalité politique française.
EP – La campagne d’Emmanuel Macron, en 2017, a fait éclater la gauche et le clivage droite-gauche. Aujourd’hui c’est la NUPES qui se porte mal. Y-a-t-il un rapprochement à faire avec la crise de la gauche des années 1970 ?
RC – Je crois que c’est très différent. Dans les années 1970, nous avons connu un véritable affrontement gauche-droite. Depuis Macron, les cartes ont été redistribuées. L’invention de « génie » (politique en tout cas…) d’Emmanuel Macron c’est d’avoir enfin dit tout haut ce que nous avons toujours dit dans nos rapports de politique de sondage. La grande majorité des Français en a plus que marre de cet affrontement stérile de « responsables » qui se succèdent, qui défont ce qu’ont fait leurs prédécesseurs, lesquels attendent de revenir au pouvoir pour tout refaire à nouveau. Le pays ne va pas si bien que ça, il y a des problèmes à résoudre, et des gens de qualité dans les deux camps. Il faudrait les mettre autour d’une table pour qu’ils essayent de travailler ensemble pour « s’en sortir », comme l’espèrent tous les Français. C’est la clé de la réussite de Macron d’avoir compris cette vérité pourtant toute simple et que nos sondages révèlent depuis des années ! Attention : cela ne veut pas dire que la gauche et la droite ont totalement disparu. Si vous demandez aux Français de se situer sur un axe gauche droite, 90 % le feront sans hésiter. Mais comme formule de gouvernement, ils veulent quelque chose qui soit plus raisonnable, plus opérationnel. Le problème c’est que nous ne savons pas comment tout cela se terminera. Macron ne pourra pas se représenter. Et après lui ? Y aura-t-il toujours un bloc « central » représenté par un seul candidat ? Difficile de répondre. Dans quel état sortiront la gauche et la droite ? Dans tous les cas, il leur faudra au moins un programme… Parce qu’à part l’écologie, personne n’a vraiment de programme. Bref, beaucoup de questions restent ouvertes. Entre-temps, il faut voir comment Macron lui-même va dessiner son propre projet. Il ne peut pas rester encore 4 ans dans cette espèce de nuage. Idem pour les autres formations politiques. Par exemple, je ne comprends pas comment, avec sa direction actuelle, la NUPES pourrait prendre le pouvoir. Le Rassemblement National, lui, surfe bien sur les attentes populaires, mais son projet n’est guère plus clair, si ce n’est ce lien trouble qu’il établit sans arrêt entre sécurité et l’immigration.
EP – Vous dites dans votre livre que l’accès au pouvoir de l’extrême droite est une utopie. Vous le pensez vraiment ?
RC – Je dis que c’était autrefois une utopie mais désormais c’est une possibilité, surtout pour la présidentielle. Ce qui a permis à l’extrême droite d’arriver au gouvernement en Italie ou en Suède peut se passer chez nous. Il peut y avoir des électeurs de droite modérée qui basculent vers la droite extrême parce qu’ils ne se sentent pas représentés dans les institutions.

EP – Est-ce que les Français seraient prêts à élire une femme ?
RC – Oui. Ce n’est plus un sujet aujourd’hui.
EP – Mais c’était encore un sujet hier, au moment de l’élection de Sarkozy en 2007 face à Ségolène Royal…
RC – Je pense surtout que la campagne de Ségolène Royal était épouvantable. Si elle, et Jospin avant elle, ont perdu, c’est parce qu’ils ont fait dans campagnes terrifiantes ! Quand Ségolène Royal proposait que des femmes policières ramènent chez elles d’autres femmes policières pour gagner en sécurité, il y a un moment où les gens se disent : mais qui a bien pu inventer ce genre de propositions ? Il me semble que beaucoup des dérapages de campagne tiennent à la personnalité de la candidate socialiste. Pour Jospin, c’est plus collectif. Autour de lui, ils étaient tous tellement sûr d’eux que la seule chose à préparer, à leurs yeux, c’était le second tour. Ils n’ont pas fait de campagne de premier tour. Ils l’ont payé cher : à peine 45 % des sympathisants socialistes ont voté pour Jospin au premier tour. Je me souviens que Jean-Marc Ayrault m’a appelé le mardi précédent le scrutin pour me dire : « Je t’appelle parce que notre expert en sondage est devenu fou : il me dit que Lionel pourrait passer derrière Le Pen ! » Je lui ai répondu : « Je pense qu’il a raison ». Et il m’a rétorqué : « Ah ? Tu es devenu fou aussi ! »
EP – L’entourage du candidat peut être une malédiction pour lui ?
RC – « Malédiction », c’est peut-être exagéré. En théorie, les gens qui entourent un candidat le protègent de ce tout ce qui pourrait le desservir. En pratique, ils finissent souvent par l’enfermer dans une espèce de bulle hermétique. Comme dans tout phénomène collectif, il se crée une espèce de fraternité qui se refuse à voir les risques parfois les plus évidents.
EP – Vous avez connu Mendès France, Rocard, Mitterrand… Chacun à sa manière personnifiait un talent politique. Quelle est la figure politique qui vous a le plus marqué ?
RC – Probablement Mendès et Rocard. Ils avaient en commun cette espèce de volonté de rigueur, de dire la vérité aux gens, ne pas broder avec les programmes, de ne promettre que ce qu’ils pouvaient tenir. Mendès était très impressionnant. Il parlait toutes les semaines aux Français en direct. Je me souviens que pendant qu’il négociait l’indépendance de l’Indochine à Fontainebleau avec Hô Chi Minh, il s’était interrompu pour rendre compte aux Français, au micro et en direct, de ce qui était en train de se passer. Il disait : « Le plus grand ennemi s’appelle la méfiance ». Je trouve que lui et Rocard ont cultivé cet état d’esprit. En ce sens, c’étaient des modèles pour moi. Mitterrand, lui, était très compliqué. Sur un plan purement politique j’ai toujours conservé une véritable distance avec lui. L’homme était ondoyant, calculateur, « politicien » au sens de la IVe République : onze fois ministre, à la tête d’un groupe pivot à l’Assemblée Nationale qui pouvait se marier avec les uns ou les autres, garde des Sceaux pendant la guerre d’Algérie il a fait condamner à mort et exécuter des prisonniers algériens par des tribunaux militaires alors qu’il n’y avait aucune preuve contre eux… Il y a quand même des choses lourdes. Mais c’est vrai que plus tard, j’ai eu l’occasion de le côtoyer durant un an et donc de discuter plusieurs fois avec lui, pendant le tournage d’un film et en étant totalement libre. Disons que les relations personnelles entre nous sont devenues excellentes alors que j’ai conservé mes distances politiques.
EP – Qui pour leur succéder aujourd’hui, en termes de talent politique et d’aura ?
RC – C’est très difficile parce qu’aujourd’hui les sondages disent Édouard Philippe. Pourquoi pas ? Mais je me demande si une partie de sa popularité n’est pas artificielle. Il a pour lui d’avoir été là. On bénéficie toujours d’avoir été connu, d’avoir été aux affaires… et de ne plus y être ! Beaucoup de gens comme ça ont été en tête des sondages : Simone Veil, Bernard Kouchner… Mais il ne faut pas confondre la simple popularité et la véritable popularité « politique », à fortiori « présidentielle ». Je dirais la même chose de tous les prétendants actuels, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et tous les autres. Difficile de prendre les paris aujourd’hui. D’autres prétendants sont peut-être plus charismatiques, mais ils sont jeunes, peut-être trop jeunes. Récemment, j’écoutais Gabriel Attal, qui a un talent inouï. Le problème, c’est qu’à la tête des grands partis de gauche et de droite, il n’y a personne. Qu’attendent-ils pour adopter des programmes sérieux et les incarner ?
EP – Qu’est-ce que la gastronomie et les plaisirs de la table disent des politiques qui nous gouvernent, notamment sur leur maîtrise (ou non) de l’image ?
RC – Politiques et gastronomie ont fait excellent ménage pendant des décennies, et la défense du terroir fait partie intégrante du scrutin majoritaire. Si vous êtes élu d’une circonscription, vous avez forcément des spécialités à promouvoir. Les politiques adorent ça et pour les avoir presque tous vus « en action sur le terrain », je peux vous dire que c’est sincère ! Ou plutôt que c’était sincère. C’est beaucoup moins le cas de la nouvelle génération.

EP – Pourquoi avez-vous parfois le sentiment de parler dans le désert comme vous le dites souvent dans votre ouvrage ?
RC – Parce que les politiques commandent des études, ils les payent, ont l’air intéressés par les conclusions. Et pourtant, au moment de prendre des décisions, on voit bien qu’ils finissent très souvent par décider « au pif » ! Parfois le « pif » tombe juste… mais en général non.
EP – Tout comme l’un de vos confrères vous lançait que « la seule éthique, c’est celle de la satisfaction client », peut-on craindre un glissement éthique du métier de sondeur au profit d’une rentabilité à court terme ?
RC – C’est un vrai risque. Il y a des moutons noirs dans chaque profession, mais nous avons quand même une chance en France. D’abord, tous les sondeurs ont gardé un lien avec l’Université. Et donc avec des politologues, des sociologues, des historiens, qui ne sont pas seulement des commerçants. Les études d’opinion sont une petite partie des instituts d’études donc ce n’est pas très important d’avoir beaucoup de contrats portant sur la politique. Deuxièmement, dans beaucoup de pays européens, les différents partis politiques ou les différents leaders ont l’habitude de travailler avec un seul institut. Ils sont donc enfermés dans la même problématique. En France, les différents acteurs politiques ont toujours travaillé avec plusieurs instituts. De même, l’État travaille avec le système des appels d’offres. Tout le monde travaille pour tout le monde, ce qui est un garde-fou formidable.
EP – Est-ce que la défiance envers les médias va de pair avec la défiance vis-à-vis des sondages ?
RC – Bien sûr oui. C’est probablement lié avec la défiance envers toutes les institutions. La confiance a baissé partout, dans les églises, dans les partis politiques, les parlements, l’école, les enseignants, les médias. Les sondeurs n’échappent pas à la règle même si « en même temps » les gens adorent les sondages ! Ils s’en servent régulièrement et en consomment régulièrement. Pour autant, nous ne sommes plus au temps où un simple sondage augmentait les ventes d’un journal…
EP – L’avènement des sondages sans méthodologie ni analyse sur les réseaux sociaux est-elle un danger pour le sondage « à l’ancienne », plus méthodique et scientifique ?
RC – Oui. Sur les réseaux sociaux, on présente en permanence comme sondages des exercices qui n’en sont pas au sens scientifique du terme. Le problème, c’est que le mot sondage n’est pas protégé. Donc on n’échappe pas à une certaine « médiocrisation » de l’instrument. Ajoutez-y le fait que les médias sont beaucoup plus pauvres qu’avant. À l’époque, on posait dix questions pour faire un peu le tour du problème. Maintenant, on en pose une, deux si on est un journal riche (rire). En même temps, la réalité que l’on sonde est de plus en plus complexe. Donc vous imaginez le résultat…
EP – Les intelligences artificielles et notamment leur capacité de « deep learning » peuvent-elles révolutionner la technique des études d’opinion ?
RC – Je pense qu’il faut un mélange. Saisir l’opinion, ce n’est pas simplement utiliser des algorithmes en partant sur des données existantes. Il y a une démarche particulière à aller vers les gens pour susciter des réactions. Ce n’est pas seulement l’intelligence artificielle, c’est l’ensemble des moyens technologiques nouveaux. C’est le fait, qu’au fond, plutôt que de demander aux gens ce qu’ils souhaitent acheter comme bouteille de cola, si on a directement accès à ce qu’enregistrent les caisses de supermarché c’est encore plus vrai que les déclarations des gens. Il existe des techniques permettant d’avoir des mesures directes sur les comportements. Et les opinions ce sont des comportements. Cela va donc réduire le temps de travail.
EP – La recherche de fond et d’analyse que suppose l’étude qualitative est-elle compatible avec les médias actuels et leur rythme de diffusion ?
RC – Oui, d’abord parce que les psychosociologues ont appris à travailler plus vite. Jadis, on estimait qu’il était impossible de faire une étude qualitative en moins de six semaines. Aujourd’hui, quand on vous donne 8 jours vous avez de la chance !
EP – Est-ce qu’il n’y aurait pas un enjeu pédagogique pour les médias et les rédactions pour comprendre comment est faite une étude ?
RC – On l’a fait plusieurs fois. J’ai publié deux fois dans l’Obs des résumés longs d’une enquête qualitative. Les retombées étaient plutôt bonnes mais ils n’ont pas renouvelé l’opération. Le problème c’est que les gens ont l’impression que c’est du journalisme, ils ont le sentiment qu’on interviewe des gens.
EP – D’après Le Monde le « off » est le nouvel outil de communication sous la présidence d’Emmanuel Macron. Pensez-vous que cela porte atteinte aux médias dans le relais de l’information au public ?
RC – Cela fait bien longtemps que le « off » est un outil de communication ! Margaret Thatcher employait de cette technique avec les journalistes. Elle les recevait et elle leur disait : « Tout en off ». Les journalistes étaient coincés, ils savaient tout et ils n’avaient pas le droit d’en parler. C’est le système de sanction le plus malin qui puisse exister ! Personnellement, je crois qu’il ne faut pas de « off », ni dans un sens, ni dans un autre. Je ne sais pas pourquoi, les présidents se sentent tous libérés dans les avions et on y apprend souvent des trucs incroyables… sauf avec Chirac qui dormait ! (Rires). Étrangement, personne ne demande aux journalistes de se mettre en « off » mais ils s’y mettent souvent d’eux-mêmes. Jusqu’à ce qu’un conseiller du président finisse par leur dire : « Bon, ça vous pouvez le dire ». Je pense que les journalistes devraient se sentir beaucoup plus libres par rapport à tout ce système, jusqu’à ce que les politiques comprennent qu’il est normal qu’il y ait des secrets d’État mais que sinon le journaliste fait ce qu’il veut.
EP – On dit que le plus important dans un voyage n’est pas la destination, mais le chemin. Que vous aura appris votre propre parcours ?
RC – D’abord, en écrivant le livre, ça m’a rappelé que je n’étais pas jeune. C’est un long parcours. Mais je n’ai pas trop perdu de temps au passage. J’ai eu l’avantage de naître dans une période où on pouvait, jeune, faire beaucoup de choses. Dans la société d’aujourd’hui ce n’est plus le cas et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle est si désagréable aux jeunes. Je mesure la chance de mon parcours, je me suis frayé un chemin en faisant des choix personnels, en rencontrant des profs, des gens qui ont marqué l’histoire ou des situations particulières, mais toujours avec une espèce de liberté que permettaient à l’époque le marché de l’emploi et l’accueil des jeunes. Ça, ce sont des choses qui me rendent un peu nostalgique de ces périodes-là. D’une certaine façon, c’était plus facile.
EP – La fiction est-elle un meilleur véhicule pour partager avec le public les réalités du monde politique ?
RC – Oui et c’est justement pour ça que j’en fais. J’ai écrit 25 livres qui ne sont pas toujours évidents à lire. Nous autres, politologues, savons des trucs sur la politique, comment ça se passe vraiment. Des trucs qu’on ne peut pas mettre dans ces ouvrages de sciences politiques. J’ai pris un risque avec mes
« Meurtres ». J’étais le premier à faire des romans dans lesquels les gens étaient sous leur vrai nom. Il y avait donc un risque considérable pour l’éditeur. Beaucoup de scènes que j’utilise dans mes romans sont réelles. Un peu exagérées de temps en temps, mais au final pas tant que cela. La difficulté, lorsqu’on écrit un roman, c’est qu’on vit avec ses personnages. C’est une écriture beaucoup plus envahissante.
Mais Jean Duchateau*, c’est terminé et ce « Voyage au cœur de la Ve République » sera mon dernier livre. Au sens propre du terme ! Quand on a rédigé ses mémoires, on ne fait plus rien. (Rires)
(*) Pseudonyme de Roland Cayrol romancier
Propos recueillis par Tobias Claiser