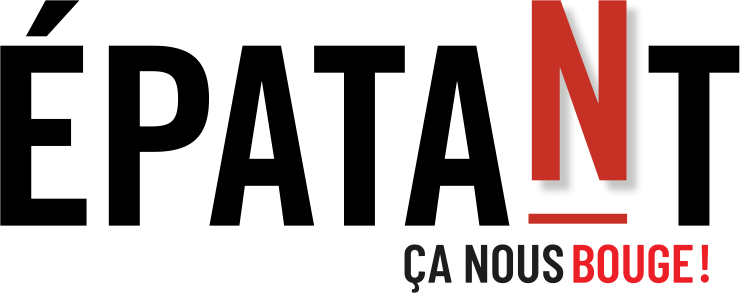Indiquer la bonne mesure des critères d’excellence et de défaillance d’un aliment… Sur le papier, la donne paraît logique, imparable. Pourtant, tout reste encore à construire. Mais dans ce contexte, l’affichage environnemental semble être une piste porteuse d’avenir.
En France, la consommation alimentaire est responsable de 22% des émissions de gaz à effet de serre[1], dont 51% concernent les produits agro-alimentaires transformés. Mais qu’il s’agisse d’un biscuit, d’une compote, ou d’un plat cuisiné, ce sont l’agriculture et l’élevage plus que les processus industriels qui pèsent sur notre empreinte environnementale. Paradoxalement, plus un plat est transformé ou composé d’ingrédients multiples, moins les impacts environnementaux – en part relative – relèvent des industriels.
Faut-il en conclure que l’agriculture et l’élevage doivent porter seuls le poids de la transition agroécologique ? Évidemment non ! Tous les acteurs de la chaîne doivent prendre leur part, mais il est essentiel de rappeler que sans transition agricole profonde, rien ne sera possible.
Encore faut-il en comprendre les ressorts. Si les industriels ont les moyens de financer cette transition, celle-ci est en outre source de rentabilité : les économies d’énergie, de matières premières, et l’optimisation des façons de travailler compensent très souvent les investissements en équipements et formations.
Ce n’est pas le cas des agriculteurs et des éleveurs pour qui la transition représente un coût important : l’agroécologie et l’agriculture biologique exigent en effet plus de main d’œuvre pour des rendements souvent plus faibles. Dans ce contexte, il faut donc étudier le coût réel du développement durable de notre alimentation.

Considérer le coût global de l’alimentation durable
Il a été clairement établi que le surcoût d’une production durable des matières premières agricoles a en réalité un impact assez faible sur le prix final assumé par le consommateur.
Prenons l’exemple d’une mesure qui a suscité des réactions négatives il y a quelques années : le durcissement de la réglementation sur les bandes enherbées. Ces bandes, implantées le long de certains cours d’eau, servent de tampon et limitent le risque de pollution diffuse par ruissellement. En 2020, la largeur minimum exigée pour ces bandes est passée de 5 à 10 mètres dans certains secteurs.
À l’époque, nombre d’acteurs ont dénoncé le surcoût entraîné par la mesure. Un grand producteur céréalier, l’estimait à… 14 millions d’euros ! En réalité, ramené au prix d’une baguette de pain, ces 14 millions d’euros ne représentaient plus qu’un centime d’euro.
Cet exemple illustre l’importance de raisonner autrement pour chiffrer le coût de la transition agroécologique. C’est d’autant plus nécessaire que toutes les pratiques agronomiques ne coûtent pas plus cher : utiliser des inhibiteurs de nitrification pour la culture de la salade coûte par exemple 15,80€ de plus à l’hectare à un cultivateur (Pour une réduction d’émissions de GES de 317 kg/ha/an), mais la suppression d’un passage d’azote qui l’accompagne fait économiser 22,70€/hectare (Pour une réduction d’émissions de GES additionnelle de 318 kg/ha/an).
La conclusion ? Il faut aller au bout de ces évaluations environnementalo-économiques pour chaque matière première agricole et animale. Nous avons besoin d’éléments financiers tangibles pour animer de façon positive et transparente, les discussions avec les industriels et les distributeurs, piloter la mise en œuvre de la transition agricole et créer de la solidarité sur toute la chaîne de valeur, de l’agriculteur au consommateur.
Le coût résiduel est le véritable coût de la durabilité de nos produits agricoles
Car qui paiera le coût résiduel, issu de la transition ? Les industriels, metteurs en marché et distributeurs peuvent et doivent en assumer une partie, mais ils n’accepteront de tout prendre au risque de déstabiliser leur modèle économique. C’est donc aussi aux consommateurs de mettre la main à la poche… et à la pâte en faisant évoluer son rapport à l’alimentation.
L’étude Nutrinet-Santé sur l’alimentation de ménages montrent que pour les familles à faibles revenus qui décident de manger bio, avec des produits plus chers, cela entraîne une réduction d’autres dépenses familiales pendant 2 ou 3 ans. A ce terme, on observe alors des changements de pratiques : manger moins et mieux, cuisiner davantage et favoriser ainsi un meilleur équilibre des dépenses. Mieux, le coût de l’alimentation diminue, pouvant devenir inférieur au budget de départ. Les quelques euros supplémentaires accordés à certains produits, grâce à de meilleures pratiques alimentaires, s’effacent donc en même temps qu’ils financent des produits meilleurs pour la santé et pour l’environnement.
L’affichage environnemental, clé de voûte de la transition agroécologique
Et pour achever de convaincre les consommateurs de jouer leur rôle, l’affichage environnemental tient un rôle central. C’est lui qui, dans les rayons alimentaires, va désigner le produit le plus favorable pour l’environnement. Son information sera également déterminante pour engager des évolutions contractuelles entre distributeurs, industriels, coopératives et agriculteurs et ainsi répartir le coût de l’alimentation durable.
L’affichage environnemental est construit sur trois niveaux.
- Le niveau 1, générique, informe sur les impacts environnementaux moyens d’une matière première : 1kg de blé, 1 L de lait ou 1kg de bœuf. Le détail de ces impacts est disponible dans la base de données Agrybalise, imaginée par l’ADEME, il y a plus de dix ans. À l’époque, Agrybalise avait permis d’éveiller les consciences des acteurs de la chaîne alimentaire et représentait à ce titre une véritable avancée. Elle est désormais insuffisante pour distinguer les produits les plus vertueux au sein d’un même rayon. C’est la raison pour laquelle deux autres niveaux ont été pensés.
- Le niveau 2 est un premier échelon de spécifications. Il permettra aux industriels vertueux ayant engagé de bonnes pratiques sur 80 à 90% des impacts d’un produit alimentaire de déclarer leurs avancées et de bénéficier d’une meilleure note.
- Le niveau 3 est l’échelon ultime, qui se concentre sur l’ensemble des impacts et des actions qui y conduisent. Ainsi, les industriels les plus engagés disposent de la meilleure note du rayon alimentaire.
Chez FoodPilot, cela fait plus de 10 ans que nous travaillons avec de nombreux acteurs publics et privés pour progresser dans cette direction. Notre collaboration est d’ailleurs une bonne illustration des nouvelles alliances qui se créent entre les secteurs privés et publics au service du bien commun.
Aujourd’hui, l’engagement de plus de dix filières industrielles et agricoles accélère le processus : l’affichage environnemental de niveau 1 a été lancé en mars 2023, les niveaux 2 et 3 sont attendus pour début 2024. Ils seront progressivement étendus en Europe, avec sept pays qui s’y intéressent déjà.
Bien sûr, ce système de notation devra être contrôlé par des organismes tiers indépendants. Il n’en reste pas moins que cette information publique, dont l’État garantira l’exactitude, permettra aux consommateurs de faire le bon geste, celui qui favorise leur santé, qui donne de la valeur au travail des agriculteurs et qui protège les écosystèmes.
Didier Livio, co-fondateur de FoodPilot.
[1] https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/notre-alimentation-c-est-combien-de-gaz-a-effet-de-serre-ges