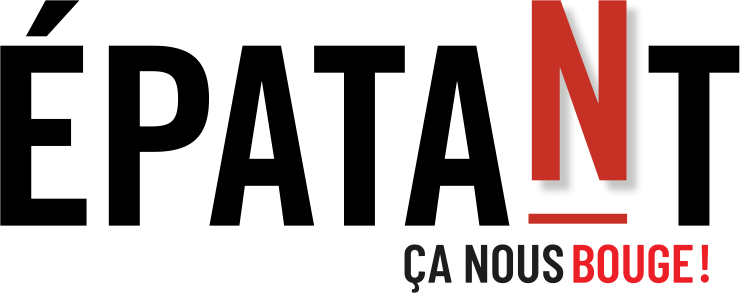Christopher Guérin est directeur général de Nexans, multinationale française de l’industrie du câble. Tut tut ! Ne tournez surtout pas cette page. Vous vous priveriez d’une soudaine envie de croire en un bel avenir.
Les câbles électriques français dans le monde sont un sujet hautement passionnant. L’homme, sa vision de l’entreprise, vous verrez, le sont tout autant. Élu second meilleur directeur général des Small-Mid Caps 2022 par les investisseurs européens, Christopher Guérin a opéré un virage stratégique majeur de son groupe, pour le repositionner sur les marchés de l’électrification durable du monde. En quatre ans, il a quadruplé sa capitalisation boursière, et multiplié par deux sa rentabilité, sans s’appuyer sur la croissance volumique ni plan social, tout en réduisant son empreinte carbone de -28%. De l’art, quoi.
Il publie, aux éditions Le Cherche Midi, Pour aller dans le bon sens : un nouveau modèle de management adapté aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Entretien fleuve avec un patron pas comme les autres.
Raphaëlle Milone : Comment vous êtes-vous mis dans cette galère ?
Christopher Guérin : Alors, ma vie c’est simple, c’est 25 ans d’échec et 25 ans de succès. D’échec parce que de ma naissance à vingt-cinq ans, c’était catastrophique.
RM : C’est à dire ?
CG : Je n’y arrivais pas. Les études, c’était très compliqué pour moi, à chaque fois les professeurs disaient à mes parents « bon, il va falloir lui trouver un boulot manuel », et mon père répondait : « mais il n’est pas plus manuel… », et apparemment, il n’était pas plus intellectuel non plus… donc l’éducation me mettait vraiment de côté. Et puis, à un moment, j’ai réussi à sortir du bois, à faire une école de commerce et je me suis révélé à partir du moment où j’ai commencé à travailler. À vingt-cinq ans, je suis parti au Pays de Galles, pendant deux ans et demi pour renforcer mon anglais. J’ai démarré comme vendeur. Je vendais des choses assez simples au début, puis un peu plus compliquées. Et je suis arrivé chez Alcatel.
RM : Vous vendiez quoi ?
CG : Au départ, j’étais dans les composants pour les charriots élévateurs chez Fenwick, et puis ensuite, je me suis retrouvé chez Alcatel.
RM : Et vous étiez un bon vendeur ?
CG : Ah oui, j’étais un très bon vendeur. Je suis arrivé chez Alcatel, dans une sous-sous-sous filiale, dans le Nord de la France, et c’est là que l’aventure a commencé. C’est un grand groupe Alcatel, quand je suis arrivé, on était 180 000. Un groupe industriel qui a complètement disparu. Et Nexans, en fait, est un des derniers bastions français de feu-Alcatel. Parce qu’en fait Nexans, c’est Alcatel Câble. Il y a eu un « spin-off » de l’activité câble, où notre ancien patron a eu le nez fin, il a senti qu’Alcatel allait partir à la dérive, a demandé la sortie et la côte en bourse en 2001 : c’est ce qui nous a sauvés. Après, Alcatel a plongé, s’est vendue à Nokia, et nous, on a réussi à faire notre vie.
RM : C’était quand ?
CG : En 1999. J’ai donc commencé par être vendeur, puis tous les ans, j’évoluais et je changeais de poste. À chaque fois qu’il y avait des causes perdues chez Nexans, et j’étais le patron des causes perdues, dès qu’il y avait des difficultés, c’était pour moi
RM : Et vous vendiez quoi à l’époque ?
CG : De la métallurgie, du cuivre. On faisait des rouleaux de cuivre pour plein d’applications. C’est comme ça que j’ai commencé à émerger, démarrer comme vendeur puis directeur des ventes, puis directeur marketing, puis directeur commercial, jusqu’à prendre la tête de l’entreprise. Il suffisait d’attendre.
RM : Nexans c’est le deuxième groupe du monde sur le secteur des câbles, c’est bien cela ? Pouvez-vous nous raconter un peu l’histoire du groupe ?
CG : Nexans est né effectivement en 1879, avec Tesla, Westinghouse, Benjamin Franklin et Edison, qui avaient besoin justement de câbles pour conduire l’électricité. Il y a eu une double invention, une invention américaine et une invention suisse. Donc les premiers câbles, chez nous, ont été faits en Suisse, à l’usine de Cortaillod, qui est à côté de Neuchâtel, et qui fonctionne encore ; c’est même le socle de notre groupe.
Sur les quatre-vingt-dix premières années, on ne faisait que de l’électrification, c’est-à-dire des câbles de haute-tension, moyenne tension, basse-tension. Haute-tension, c’est les câbles des grands pylônes de RTE qui sont au bord de la route à trente mètres de hauteur par exemple. La moyenne tension, c’est tout ce que vous ne voyez pas, tous les câbles enterrés dans les villes. C’est Enedis pour la version française. Actuellement, il y a des chantiers partout, vous ne savez pas pourquoi, parce que nous ne voyons pas grand-chose. En fait, ils déterrent les câbles pour les remplacer dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, car il n’y a pas assez de bande passante électrique.
Le réseau électrique en Europe a cinquante ans d’âge, ils remplacent donc les câbles de 1955-1960, par de nouveaux câbles. C’est exactement ce qu’il s’est passé pour les télécoms, les câbles cuivre ont été remplacés par la fibre optique, sauf que ça a été fait sur dix ans.
RM : La durée de vie d’un câble, c’est cinquante ans ?
CG : Trente ans normalement. Donc on a un risque d’obsolescence qui a dépassé les normes. Les câbles aujourd’hui sont usés et rongés par les rats. Ils étaient à base d’huile et de plomb, donc ils polluent les sols. Aujourd’hui on n’utilise plus de plomb ni d’huile pour nos câbles, ce sont des câbles bas-carbone, avec des polymères recyclables. Le problème, c’est qu’il faut les enlever, et le coût de démantèlement est extrêmement cher.
RM : Un câble, c’est toujours du cuivre ?
CG : À 70% c’est du cuivre et à 30 % c’est de l’aluminium.
RM : Et pourquoi l’aluminium ?
CG : L’aluminium est une alternative moins chère. La valeur à la tonne du cuivre, c’est huit mille euros, alors que l’aluminium n’en coûte que trois mille euros. Donc, si vous voulez faire de très grandes autoroutes, de grandes longueurs, si vous n’avez pas de problème d’espace, parce que comme la conductivité est plus faible, il vous faut faire des diamètres plus gros, alors vous pouvez utiliser éventuellement l’aluminium. Il y a l’or et l’argent aussi. Argent, cuivre, or, aluminium : ce sont les 4 possibilités, les meilleurs conducteurs d’électricité. Alors, déjà que nous subissons des vols sur le cuivre, vous n’imaginez pas l’or ou l’argent !
Et donc, les quatre-vingt-dix premières années, on a participé aux deux grands cycles du siècle dernier. Le premier cycle de l’électrification, c’était 1890-1910 : là, on a commencé à mettre beaucoup de câbles en réseaux électriques.
Et la deuxième grande période, c’est bien sûr l’après-guerre et les Trente Glorieuses, 1950-1970, « génération électricité », on a mis des câbles pour tout, dans tous les réseaux. Ce sont les deux grandes périodes. Après, entre ces deux périodes et depuis les années 70, on peut dire qu’on a été sur de la maintenance, c’est-à-dire qu’on a tenu, géré le réseau, et augmenté les réseaux.
RM : Et après ?
CG : On s’est diversifiés et on est désormais présents dans quarante pays. Aujourd’hui on opère un recentrage stratégique pour les dix prochaines années sur l’électrification uniquement.
RM : Pourquoi se re-concentrer sur l’électrification ?
CG : La précédente vague d’installation réalisée entre 1950 et 1970 doit se renouveler, pour la troisième fois. Nous rentrons donc dans un hypercycle de demande, Nexans doit être agile et en ordre de marche pour y répondre.
« ON DOIT BÂTIR L’INTERNET DE L’ÉNERGIE »
RM : À cause des nouvelles technologies ?
CG : Non, plus simplement, ce n’est pas une question de techno. Pour vous expliquer : 70% de l’électricité est actuellement produite par les énergies fossiles et nous sommes en train de basculer vers les énergies renouvelables. Pour ça, il faut câbler les fermes solaires,les fermes éoliennes en mer ou terrestre, et ça nécessite énormément de câble, énormément de cuivre.
Sur la transmission, c’est ce que vous ne voyez pas, mais il y a pas mal de cartes qui le montrent : il ne faut plus regarder l’Europe au travers de ses frontières mais au travers de ses réseaux d’interconnections. Celui des Télécoms, déjà, représente un million de kilomètres de fibre optique qui relie l’ensemble des régions du monde, et vous avez actuellement plus de 80 000 kilomètres de « câbles d’énergie » qui relient le monde. Actuellement, notre secteur va dérouler à peu près 6 000 kilomètres de câble entre Afrique Moyen-Orient et l’Europe. Ce sont des câbles sous-marins, qui vont aller chercher la puissance des fermes solaires en Afrique et au Moyen-Orient, et qui vont amener cette puissance solaire en Europe.
RM : Sans déperdition ?
CG : Sans déperdition. Et là, ça s’accélère parce que c’est l’alternative aux pipelines de gaz russes. Par exemple, pour l’Allemagne qui est hyper dépendante du gaz russe, on essaie de trouver des alternatives plus propres et plus durables.
RM : C’est en continu ?
CG : En fait, la problématique, c’est qu’on n’a pas encore l’acteur industriel qui a inventé le stockage de l’énergie à très grande échelle. Donc toute énergie comme elle va et vient, on ne peut pas la « maîtriser », la stocker pour l’utiliser au bon moment. Contrairement au pétrole. Le soleil c’est le soleil, le vent c’est le vent. Donc pour éviter la perte de cette électricité générée, on doit bâtir l’internet de l’énergie.
RM : Il faut que ce soit consommé instantanément ?
CG : Une fois sur le réseau, l’énergie doit être consommée instantanément, sinon c’est perdu. En ce moment, vous avez un réseau électrique qui est en train de se mettre en place partout en Europe. Nexans y contribue grâce à l’un de ses 2 immenses bateaux qui transporte 10 000 tonnes de câble, c’est le poids de la Tour Eiffel. En réalité ce sont bien plus que des bateaux, ce sont de réelles plateformes industrielles où évoluent quatre-vingt-dix personnes dont vingt ingénieurs.
A la différence de la fibre optique, les câbles d’énergie ne sont pas aussi simples à poser… Comment on procède… On va poser les câbles sur les routes qui sont dessinées à l’avance pour ne pas abimer les fonds sous-marins, les coraux et cetera. On a donc un robot qui descend, creuse la tranchée dans le fond, on y dépose le câble à l’intérieur, on le scelle avec le sable, puis on déroule sur mille kilomètres de longueur.
RM : Est-ce que vous planquez tout ça aussi par mesure de sécurité ? Comme on a pu voir pour le gaz, avec des attaques terroristes ?
CG : Non, les actes terroristes sont plus sur le télécom que sur l’énergie. Alors, à un moment donné quand tout sera interconnecté, il y aura un sujet de cyber-sécurité. Nous, on a des fibres optiques dans nos câbles énergie qui nous permettent de contrôler s’il se passe quelque chose. On suit ça à la minute pour nos clients. Parce que nous ne sommes pas dans la gestion de l’énergie, on pose l’ensemble du système pour que ça marche, et une fois que le système est posé, on le transmet à nos clients opérateurs d’énergie et c’est eux qui en ont la gestion. Comme Orange gère le réseau télécom par exemple.
RM : Et ça coûte cher au kilomètre ?
CG : La connexion programmée, par exemple, entre Israël, Chypre et la Grèce, est une liaison pour aller chercher l’énergie solaire à Chypre, en Israël pour l’amener en Europe mais également alimenter ces pays-là en électricité. C’est 1 200 kilomètres de distance, et le projet représente un milliard cinq millions d’euros, de câbles uniquement, installation incluse.
RM : Donc c’est cher, mais pas tant que ça au fond ?
CG : Non, sur les fermes éoliennes, notre sujet ce sont les liaisons d’interconnexions entre les fermes et le réseau électrique, en moyenne c’est 15 kilomètres de distance, mais maintenant ils installent des fermes à 160 kilomètres des côtes, comme en Ecosse, dans des zones ayant le plus faible impact sur la biodiversité. Dans cette zone avec les vents forts, les éoliennes tournent à 100%.
Pour finir, la distribution c’est donc le réseau électrique, avec Enedis. Et puis l’usage, c’est les éclairages, c’est l’énergie dans les bâtiments, les centres commerciaux, les centres de données qui pompent énormément d’énergie, rien qu’en France, on va avoir 400 000 bornes de charge de véhicules électriques à câbler. C’est un défi. Ce sont des extensions de réseaux. C’est comme pour la fibre optique : vous avez le réseau, et après il faut aller dans les bâtiments pour les connecter.
RM : Et les data centers, ça représente quoi en consommation aujourd’hui ?
CG : Les centres de données ont besoin d’autant d’énergie que tout le secteur aéronautique. Oui, parce qu’il faut que ce soit toujours à température constante. La surchauffe constante impose de réguler avec un système d’air conditionné.
RM : Et donc, cette transition des énergies fossiles vers un internet de l’électrique et du solaire, ça prendrait combien de temps ?
CG : Ce sont des cycles de vingt à trente ans. On rentre dans les nouvelles trente glorieuses de l’électrification, parce que l’électrification c’est la voie la plus rapide vers la décarbonation du monde. Plus vous réduisez votre dépendance au pétrole et au gaz, plus vous réduirez vos émissions de CO2.
RM : Vous disiez qu’on était aujourd’hui à 70% d’énergies fossiles et 30% de renouvelables. On en sera où dans vingt ans ? Normalement, on aura réussi à inverser le modèle actuel ?
CG : Oui. C’est la motivation de toutes les nations actuellement. Un ministre saoudien avait dit « l’âge de pierre ne s’est pas arrêté par manque de pierre, l’âge du pétrole ne s’arrêtera pas par manque de pétrole ». C’est la volonté des gouvernements de basculer vers les énergies renouvelables, et actuellement, il y a énormément de demande.
RM : Les investissements, les capitaux suivent ? Vous avez quadruplé la cotation en bourse, comment ça s’est fait ?
CG : Il y a trois grands acteurs dans le monde, dont Nexans fait partie. On me pose toujours la question « est ce que la transition énergétique est en marche ? », et je réponds toujours oui. J’ai un indicateur : le carnet de commande, depuis quinze ans, de ces trois acteurs dans cette zone-là représente en cumulé entre deux et cinq milliards d’euros au total et aujourd’hui on va finir l’année à trente milliards d’euros, à trois. Soit une multiplication par 6 ! La meilleure démonstration que la transition énergétique est bien en marche.
RM : C’est considérable en effet.
CG : L’Europe a annoncé qu’ils allaient mettre 100 Gigawatts de fermes éoliennes en mer, financées par l’Europe. Le plan IRA de Biden, c’est 50 Gigawatts. Plus toutes les transmissions. Les États-Unis doivent déployer 20 000 kilomètres de câbles haute-tension, pour connecter l’Est du Pays à l’Ouest, et le Nord avec le Sud. Donc, on est portés par ces nouvelles trente glorieuses.
RM : Vous dites qu’on est limité en cuivre ?
CG : Oui, en fait la consommation mondiale de cuivre est à peu près à treize millions de tonnes en 1995. Globalement là on est passé à vingt-neuf millions de tonnes en 2020. Donc on est à seize millions de tonnes de plus en l’espace de vingt-cinq ans. En revanche, pour la première fois dans l’histoire de l’électricité, toutes les nations vont dans le même sens en même temps, c’est à dire le basculement sur les renouvelables. Les États-Unis ont un réseau vieux de quarante-cinq ans, l’Amérique du Sud également. La Chine investit beaucoup sur la transition énergétique. Tout le monde parle de véhicules électriques ; ce qui fait que tout le monde va vers l’électrique. Donc la consommation mondiale du cuivre, aujourd’hui à vingt-neuf-millions de tonnes, est annoncée à trente-neuf millions de tonnes pour 2030. En moins de dix ans, on va avoir la même hausse de demande que ce que l’on a eu en vingt-cinq ans.
Donc, le cuivre ne suit pas. J’étais au Pérou la semaine dernière, on a refait le tour des mines : ils sont verrouillés à vingt-quatre millions de tonnes, ils sont incapables pour l’instant de monter à trente-neuf.
RM : Comment on fait ?
CG : Le sujet c’est le recyclage. Parce que vous allez démanteler beaucoup de vieux réseaux. Et on n’arrête pas de dire à nos clients : « vos déchets d’aujourd’hui sont votre croissance de demain ». Il faut impérativement accélérer le recyclage.
RM : Vous proposez ce service ?
CG : On est capables de recycler oui. Avec Suez, on a une joint-venture, et Nexans a une énorme fonderie de cuivre à Lens, la seule en France qui est capable de recycler les métaux non ferreux : on recycle les polymères d’un côté, les métaux comme le cuivre et l’aluminium de l’autre. Le grand avantage du cuivre, c’est qu’il est recyclable à l’infini. On a accumulé cinquante ans de cuivre sur notre territoire. Aujourd’hui, on est assis sur des mines urbaines. Il faut les démanteler.
RM : Les Russes ont beaucoup de cuivre ?
CG : Non, en revanche ils ont beaucoup d’aluminium. 75% de la production mondiale du cuivre vient du Chili, du Pérou et de la Chine. Et la dépendance à l’aluminium avec la Chine est énorme. Donc si la Chine ferme l’accès à l’aluminium, on devra faire face à un problème majeur. Si l’Europe décide de bannir l’aluminium russe, comme ils l’ont fait pour l’acier, on n’est pas bien non plus. Donc le problème en Europe c’est qu’on a une ambition qui n’est pas associée avec les ressources naturelles. On n’a pas de ressources naturelles : pas de lithium, de cobalt, de cuivre, d’aluminium… donc on est très dépendants de ces régions du monde.
RM : Et on peut tenir avec le recyclage sur le long terme ?
CG : Non, le recyclage ne suffira pas.
RM : Et on ne peut pas inventer une sorte d’alliage ?
CG : Ça aurait été déjà fait. On peut avoir des alliages mais c’est extrêmement cher. Donc non, le recyclage ne suffira pas. À un moment donné se posera la question de savoir si l’on préfère que le cuivre aille dans un véhicule électrique ou bien dans une ferme éolienne en mer : il faudra faire des choix.
RM : Ce qui nous intéresse aussi, c’est votre bouquin. Votre façon de gérer la boîte, les hommes. Dans Pour aller dans le bon sens, vous postulez qu’il n’existe pas, actuellement, de modèle de management adapté aux défis d’aujourd’hui. Vous faites le constat d’un modèle de société et d’un monde à bout de souffle, dans un environnement très disruptif, marqué par des crises graves et multiples. Pour y faire face, il faut selon vous une approche systémique, holistique, globale d’une certaine manière, et vous inventez un nouveau modèle de management, L’E3. Pouvez-vous nous l’expliquer ?
CG : Je vais essayer de vous l’expliquer plus simplement que dans le livre. En fait, cette notion de contrainte avec le cuivre que je vous ai exposée, je l’ai imposée dans le management de l’entreprise. C’est à dire que j’ai mis de la contrainte partout. Et j’ai dit à mes équipes : « l’ère de l’abondance est terminée, on entre dans l’ère de la rareté. » Mais pas uniquement du cuivre. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on est une des rares entreprises cotées en France qui ne s’engage pas sur la croissance. Moi je ne parle pas de croissance. Ce qui est très problématique pour une société cotée, parce qu’aujourd’hui les entreprises cotées sont valorisées par les profits qu’elles réalisent, mais également la croissance qu’elles génèrent tous les ans. Et nous on ne donne pas d’objectif de croissance, c’est pour ça que parfois on est sous-cotés, parce que ça ne rentre pas dans le modèle. Vous allez voir des analystes financiers, ils vont vous dire « c’est quoi votre taux de croissance ? », et je leur dis « je m’en fous, ce n’est pas mon sujet ». Mon sujet c’est d’allier profit – car nous sommes cotés, et baisse de notre empreinte carbone. On ne veut pas faire du green washing, on veut faire du green acting. On s’est donc demandé, vraiment, ce que nous devions faire, pour à la fois générer du profit, et baisser notre empreinte carbone.
La première chose qu’on a faite, c’est d’enlever 13 000 clients sur 17 000. Moi je suis un vendeur, ce n’est pas dans la logique d’un vendeur de dire « je vais me séparer de clients ». Même aujourd’hui dans les écoles de commerces récemment, dans les bouquins actuels il n’est pas écrit qu’il faut se séparer de clients.

RM : Il y a des clients chiants.
CG : Justement, on les a appelés « le mauvais cholestérol ». En fait on a pris les techniques de l’assurance et de la banque. Vous savez, quand vous allez faire un emprunt, on vous pose plein de questions pour déterminer votre capacité d’endettement. Donc on vous profile, est-ce que vous êtes un client stratégique, pas stratégique, etc. On a fait la même chose pour l’ensemble de nos clients, sur les 17 000, sur une logique de stratégie, de risque, profil de risque financier, et puis profil environnemental. Est-ce que servir ce client, à mille kilomètres de distance de l’usine, par exemple, est profitable ? Oui. Mais est-ce qu’il est vertueux également d’un point de vue environnemental ? On en a fait des scores. Pour les vendeurs on a fait des choses très simples : on a dit il y a les clients « Platinum », et il y a les autres. On a quatre mille clients « Platinum », donc ceux-là on va mettre le paquet dessus, et on va retirer tous les autres. Donc on a supprimé 15% de chiffre d’affaires, du jour au lendemain, et en fait, le Covid a été un accélérateur pour ça.
On parlait de systémie. On a expliqué à nos équipes : une crise sanitaire génère une crise de revenu, une crise de revenu génère une crise de marge pour une société, une crise de marge génère une crise de trésorerie, de cash, et si vous n’avez plus de cash, c’est une crise sociale, vous ne pouvez plus payer vos employés. On leur a dit « on est d’accord, on va éviter la crise sociale. Donc tout le monde sur le cash ». Et à ce moment-là on s’est dit, pendant cinq mois, on retire tous les autres clients, on ne sert que les clients catégorisés « Platinum ». On a fait la même chose sur les produits, on en a supprimé 40%. Et en fait ce que les gens ne savent pas, c’est qu’on peut générer énormément de profit, avec moins de volume. Et c’est ce qui s’est passé, on a doublé notre profitabilité, on n’a jamais généré autant de cash, parce qu’en fait, le surplus de clients et de produits généraient beaucoup de pertes qui n’étaient pas visibles par les normes comptables. Je ne veux pas être trop financier par rapport à votre magazine, mais je termine juste, avec l’exemple d’Apple, qui pour nous vendeurs marche plutôt pas mal. Quand Apple lance l’Iphone 15, on voit le côté mercantile du système, disons du « toujours plus ». C’est indéniable. Mais moi je regarde le côté industriel : c’est que quand vous visitez l’usine de Foxconn, ils n’ont toujours qu’une seule famille de produits à produire, ils n’ont pas la 12, la 13, la 14 et la 15. C’est-à-dire qu’ils ont un indice de complexité toujours constant. Une seule famille de produit. C’est pour cela qu’ils arrêtent les autres familles, parce que s’ils empilaient la production du 12, 13, 14, 15, là ils commenceraient à perdre énormément d’argent. Et bien c’est un peu la même logique.
Les injonctions paradoxales que vous entendez tous les jours dans les médias, ou chez les dirigeants : volume versus valeur, profit versus social ou environnement, croissance versus sobriété… on n’arrête pas de dire que l’on est en ressources contraintes, et qu’à partir du 18 juillet on a consommé toutes les ressources de la terre, mais rien ne change. Et puis face à ça, on a la Commission Européenne qui nous met des labels partout. Alors actuellement, pour les ESG (ndlr : notations en matière environnementale, sociale et gouvernance), il existe deux mille indicateurs et mille cinq-cents labels. On collectionne les labels comme les magnets sur un frigo. Donc on s’est demandé comment repenser le système, et c’est comme ça qu’on a créé notre programme, qui s’appuie sur le concept dit « Triple P », pour « Profit, People, Planet », qui philosophiquement existe depuis 1970, mais il n’y a eu aucun écrit opérationnel, qui pose la question de comment on le met en pratique. On a été voir les universités les plus prestigieuses du monde, pour savoir s’il y avait des formations disponibles sur marché, on a lu une quarantaine de bouquins sur l’ensemble de ce périmètre « économie et environnement », pour voir s’il y avait un bouquin qui exprimait les choses de manière un peu plus holistiques.
RM : Avez-vous trouvé une matière intéressante ?
CG : On a vu des choses en silos qui étaient formidables : formations financières, environnementales exceptionnelles, mais il n’y a rien qui fasse le pont entre tout ça. Donc on s’est dit, on va d’abord balayer devant notre porte et puis on va regarder nos activités. Et on a d’abord démarré par les activités les plus rentables depuis dix ans, on va regarder un peu comment elles se comportent sur l’environnement et sur l’engagement, et on a vu le résultat, c’était plutôt pas mal : émissions de CO2 assez faibles, pensée éco-design, recyclage de 100% de leurs déchets. Sur la partie sociale, c’était bien aussi. Un taux d’engagement très fort, des risques de sécurité très faibles, une diversité homme-femme beaucoup plus équilibrée que la moyenne du groupe : cinq à dix points de féminisation des instances dirigeantes plus forte que la moyenne du groupe, et des niveaux de formation assez élevés.
On a pris à l’opposé nos activités qui étaient en difficultés financières depuis très longtemps. Et on s’aperçoit qu’elles n’ont pas juste un problème financier : sur la partie environnementale c’est un désastre, en fait ce n’est même pas un sujet, il n’y a pas de conscience environnementale. Pas de recyclage par exemple. On a dix-huit usines sur soixante-dix qui émettent 40% des émissions de CO2 du groupe. Il n’y a aucun facteur exogène qui explique ça.
Donc on a écrit notre modèle E3. On va le simplifier au début, mais il faut que nos usines soient « E3 compatibles ». On voit bien que ce n’est pas un problème de CAPEX, ce n’est pas un problème d’indicateurs, c’est un problème de management. Il y a des managers qui ont une conscience sociale et environnementale. Entre les années soixante et quatre-vingt-dix, vous aviez plus de patrons qui avaient cette conscience environnementale et sociale, que parfois aujourd’hui. On pourrait croire que dans la modernité dans laquelle on vit aujourd’hui, les patrons sont davantage conscients, en fait, non ! On avait des patrons qui étaient beaucoup plus holistiques à l’époque.
RM : Qu’est ce qui a changé ?
CG : Les années 2000 ont alimenté la pompe au silotage. Il faut les meilleurs acheteurs, les meilleurs vendeurs, les meilleurs financiers… mais en fait, chacun est parti dans son petit silo, et on a perdu la vue globale de l’entreprise. Et c’est ce qu’on essaie de remettre en place chez Nexans.
RM : Et au niveau mondial, quelle est votre vision, en tant que grand patron parmi les grands patrons, est-ce qu’il y a une vraie prise de conscience, mondiale et globale, de ce que vous venez de nous expliquer ? Comment ça se passe, par exemple, entre un Chinois, un Russe et un Européen, vous vous serrez la pince, vous vous regardez dans les yeux en vous disant « allez les gars, on y va » ?
CG : Les chinois vont très vite de manière générale. Ils ont très vite pollué le monde, comme ils vont très vite le dépolluer. C’est la première région du monde en termes de nombre de véhicules électriques. Le problème c’est qu’on rentre dans ce que j’ai appelé dans le bouquin « les architectures invisibles », qui est le système, en fait. On est pris par le système. Un patron, il est jetable comme un kleenex : s’il n’est pas dans le système, à un moment donné, il sera remplacé par un autre.
Alors, oui, il existe plein de patrons qui ont cette conscience-là, mais le système n’exprime pas cette conscience. Encore moins pour les sociétés cotées. Dans les entreprises familiales, vous le trouvez : elles sont sur un temps long, elles distribuent comme elles veulent, sont moins regardées. Nous, de reporter nos résultats au trimestre, où les analystes – ce qui ne veut pas dire les investisseurs – regardent essentiellement la croissance et la profitabilité, et quand on a cinq minutes on parle un peu d’environnement, et bien le problème c’est le système. C’est le système qu’il faut changer. On est rentrés dans l’hyper-financiarisation du monde où les indicateurs financiers priment.
RM : D’ailleurs, qui est le plus gros porteur chez vous ?
CG : On a un actionnaire Chilien, et on a la BPI. À eux deux, ils couvrent 30% du capital de Nexans, après c’est du flottant, et ça ne dépasse pas plus de 2% par investisseur.
RM : Et c’est un Chilien qui a des mines ?
CG : Oui, il a des mines, mais on n’achète pas notre cuivre chez lui, car je ne voulais pas de conflit d’intérêt entre la position d’actionnaire et de fournisseur.
RM : Pensez-vous que, structurellement, en fin de compte, on puisse réconcilier capitalisme et sobriété ? Autrement dit, la sobriété comme source de profit, c’est donc possible ?
CG : Oui. Notre modèle et ses résultats en sont la preuve. Les indicateurs de nos profits sont tous au vert, on a supprimé 80% de la base clientèle, 30 à 40% de la base produits, et on est en route pour 630 millions de résultat… avec un milliard huit de cash. Avant, on était à 300 millions pendant dix ans… Donc oui, capitalisme et sobriété sont tout à fait compatibles. Pourquoi la sobriété ? Parce qu’avec moins de croissance volumique, c’est à dire que je consomme de plus en plus de ressources naturelles, et ça ne veut pas dire que je ne fais pas de croissance, mais elle est en valeur, c’est-à-dire que je vends plus de produits à valeur ajoutée, et je travaille avec des clients qui sont prêts à payer plus de services que les autres, qui voulaient juste du câble comme on achète de la baguette de pain.
Donc, avec moins de croissance volumique, moins de clients, en réduisant les coûts de complexité, sur la partie environnementale, ça nous donne -28% d’émissions de CO2 en 2022, et à 2023, on est à environ -30%. -28%, c’était notre objectif pour 2026. On a trois ans d’avance, parce qu’il n’y a pas eu de croissance volumique. En consommation de matière, nous sommes à environ -20%, par rapport à 2019, donc c’est pour cela qu’on dit que la sobriété peut être source de profit.
Notre objectif est de trouver, dans le système, une possibilité de réduire les émissions de carbone, tout en générant du profit.
RM : Dans votre livre, vous dites que vous pouvez renouveler complètement votre modèle de management pour le rendre viable à la fois écologiquement et environnementalement, et sans qu’il y ait de casse majeure au niveau social…
CG : Oui, alors, il faut être honnête. Le fait que l’on soit moins sur la croissance volumique, fait qu’avant, on utilisait des intérimaires, et qu’on n’en utilise pas aujourd’hui. C’est-à-dire que nos opérateurs et opératrices de production, qui sont en CDI, n’ont pas été touchés du tout. En revanche notre volume d’intérimaire a fortement chuté. Il n’y a pas de miracle. C’est-à-dire que si vous produisez moins, il arrive un moment où vous avez moins de main d’œuvre. Mais, chez Nexans, on est restés à un niveau où il ne peut pas y avoir de casse sociale au sein des usines.
La partie sociale, ça c’est le troisième pan de l’E3. On s’est aperçu que moins de clients égale moins de produits, en fait, cela a allégé la charge de travail des opérateurs de production, et a amené de la productivité. Et l’on sait qu’il y a un grand sujet en Europe, c’est la source de productivité. En France aussi, c’est un gros sujet. L’institut Gallup a montré l’engagement des salariés dans les entreprises au niveau mondial. Les trois pays les moins engagés du monde, c’est France, Italie, Japon. Vraiment les derniers de la classe. Seulement 6% des employés dans les entreprises françaises viennent de manière engagée au travail. Alors qu’en Colombie c’est 45% et en Allemagne c’est 25%. Actuellement, on travaille avec dix sociologues, on essaie de comprendre pourquoi il y a un problème de désengagement en France. Notre diagnostic c’est que les entreprises aujourd’hui, ont un narratif fait par des cols blancs, pour des cols blancs. On n’a pas un narratif de cols bleus, même si c’est un peu péjoratif de dire col bleu. En ce moment, on est en train de faire un résumé du fameux, du fabuleux documentaire de Béziat qui est passé sur France 2, qui s’appelle Nous les ouvriers, je vous le recommande il est juste fantastique, on est en train de le diffuser dans nos usines. Il explique le monde ouvrier de 1900 à nos jours, et il montre bien qu’à chaque fois qu’il y avait des crises, à chaque fois qu’il y avait des guerres, le monde ouvrier était toujours sur le front. À produire, à aider, et cetera. Comme tout le personnel médical.
Alors moi, j’ai essayé de porter ce message : arrêtons de créer un fossé entre le col bleu et le col blanc. Entre ceux qui sont à la maison devant un ordinateur, et ceux qui vont au boulot, qui sont sur une machine, dans un hôpital, dans un supermarché. Donc on essaie de retravailler notre narratif d’entreprise. Ce que l’on est en train de corriger avec les sociologues, c’est qu’on a un narratif de grand groupe, « electrify the future », ok, à la fin l’ouvrier sur sa machine, il se dit bon mais moi je fais du câble. On parle d’un grand groupe, on parle raison d’être, lui il se dit « je suis dans un village, donc c’est quoi la projection de mon usine à dix ans, c’est quoi la production de ma machine à dix ans ? Il faut qu’on ait un discours beaucoup plus industriel par rapport à cette population, pour les toucher, parce que moi une grande majorité de ma population. Donc on fait un très gros travail social.
RM : Sur le volet social du livre, vous parlez aussi de l’absentéisme…
CG : Oui, on utilise l’absentéisme courte durée, donc hors-longue maladie, pour regarder le baromètre du management. Là on était dans une usine dans les Ardennes : 10% de taux d’absentéisme depuis dix ans. On a mis un nouveau patron, une nouvelle équipe : en un an et demi, plus d’absentéisme, plus rien. On a essayé de comprendre ce qu’il a fait, et il a mis en place de belles initiatives : transparence, pas de réunions confidentielles, même quand il y a un comité de direction, on affiche les sujets, et on affiche les résolutions. On favorise la participation du monde de la production aux réflexions et discussions sur “l’usine de demain”, on fait venir les clients pour parler à tout le monde, pas juste à un vendeur. On arrête l’usine, le client parle à deux-cents personnes.
On veut absolument éviter le style militaire caché où tout est confidentiel : ce n’est pas un management bienveillant. C’est complètement à l’opposé.
Donc on a codifié tout ça, et on commence à former nos équipes dans ce sens-là.
RM : Est-ce que les ouvriers ont une sorte d’intéressement, de prime à la décarbonation, que sais-je ?
CG : J’essaie de ne pas faire de compensation financière sur l’environnement. C’est comme sur la sécurité. Je n’ai pas à donner des primes pour ne pas que l’on se blesse. Notre rôle, c’est d’assurer la sécurité de nos ouvriers. Ce qui est intéressant, c’est que dans le modèle E3, sur le prisme environnemental, c’est cette population-là qui prend le plus le sujet. C’est eux qui lancent le plus d’idées de recyclage, de repenser les modes de production, et cetera. Le management est plus en retard par rapport à ça. Là le bouquin, on l’a envoyé dans toutes les usines, et il a été lu par les syndicats, et en fait, le bon sens il n’est pas là où on pense : on trouve plus de bon sens sur ces sujets-là quand on va sur le terrain que quand on monte dans la hiérarchie.
RM : Et ce modèle de simplification et de sobriété que vous nous avez expliqué, est-ce que vous l’appliquez aussi à titre individuel, dans votre famille par exemple ?
CG : Oui, bien sûr, ce tout qui relève de la simplification c’est nécessaire. Moi je suis en métro, j’ai une voiture électrique que j’utilise très peu. Pour moi, la voie royale c’est la simplification.
RM : Pour finir cet entretien, et toujours sur le volet environnement, vous dites que notre ennemi ne peut pas être la finance : c’est-à-dire ?
CG : C’est-à-dire qu’on ne gagnera pas. Ce qu’il faut, c’est faire avec.
RM : C’est avec les investissements massifs qu’on va y arriver ?
CG : Bien sûr. Lors d’un débat sur le sujet, je me souviens d’un activiste qui s‘était fait un peu challenger par un investisseur qui était dans la salle, qui lui disait « oui mais qui c’est qui va payer tout ça ? Qui c’est qui va vous payer vos usines ? Qui c’est qui va vous payer vos outils de productions ? » On trouve beaucoup d’investisseurs qui sont dans cette logique-là, aujourd’hui en France il y en a pas mal.
RM : Je reviens un instant sur la finance, et sur les énergies fossiles, car elles me paraissent tellement indéboulonnables, quand on voit les fortunes que cela représente, et qu’elles restent les principales locomotives de la bourse… ne pensez-vous pas que ça va avoir du mal à bouger ?
CG : Non, c’est déjà en train de changer. Actuellement, vous avez plus de financement dans les énergies renouvelables que vous en avez dans le pétrole. En revanche, les sociétés pétrolières sont autofinancées…
RM : Total par exemple, ça bascule, au niveau des investissements ?
CG : Total oui. Ils vont mettre énormément d’argent sur les énergies renouvelables.
RM : Vous plaidez pour des quotas carbones, à tous les niveaux, pour toutes les entreprises, mais vous pointez aussi des incohérences majeures, pouvez-vous expliquer cela ?
CG : L’initiative du quota carbone est très intéressante. Bon, comme on l’a vu dans la série qui vient de sortir avec Vincent Lindon, il y a quelques malins qui s’en sont servi pour détourner de la TVA, mais c’est intéressant. Nous par exemple, on applique des quotas carbone par usine. Là on était au Maroc au début de l’année, on leur a dit : « votre objectif de profitabilité c’est 10%, très bien, en revanche votre empreinte carbone doit baisser de 10 % ». On ne leur donne pas d’objectif de croissance. Et le fait d’avoir une double contrainte, de dire je dois faire plus de profit, mais je dois réduire mon empreinte carbone en même temps, fait que je ne peux pas utiliser la case croissance. Donc, une double contrainte, c’est-à-dire une sorte de tunnel qui a ses limites, fait qu’ils sont obligés de déterminer les clients et les produits qui répondront à la double contrainte. Ce client est bon pour ma profitabilité, l’est-il aussi pour mon quota carbone ou pas ? C’est pour cela qu’on les force à aller dans ce sens-là.
RM : Peut-on revenir très rapidement, pour que ce soit bien clair pour nos lecteurs, sur la différence entre profitabilité et croissance ?
CG : Aujourd’hui, la profitabilité, dans le quotidien des entreprises, est souvent associée à « le plus de volume », « je vends plus, donc je fais plus de profitabilité ». Et ça, c’est vrai, techniquement, économiquement, mais il y a d’autres solutions, qui sans croissance volumique, vont permettre d’atteindre le même retour sur la rentabilité. Et ce que les entreprises gèrent mal aujourd’hui, c’est que plus vous avez de clients, plus vous avez de produits, plus vous faites de la perte financière que vous ne voyez pas. Et d’arrêter cette perte que vous ne voyez pas, c’est faire des gains.
Mais je vous rassure, même pour les financiers c’est difficile à comprendre. Quand je leur montre mes tableaux, ils voient le chiffre d’affaires qui ne bouge pas, les frais fixes qui ne bougent pas, on n’a viré personne, on n’a pas fait de croissance, et le profit a fait fois deux. Les financiers ne comprennent pas ! Parce qu’ils n’ont pas été éduqués comme ça.
RM : Vous terminez le livre en disant qu’il faut réinventer le grand patron. Que vous avez besoin d’ambassadeurs, de nouveaux dirigeants « E3 compatibles ». Comment envisagez-vous ce challenge ?
CG : Je pense que, de la même façon que nous sommes dans les trente glorieuses pour l’électrique, c’est la fin d’un monde, le monde de l’abondance, et on rentre dans un nouveau monde. Et qui dit basculement de civilisation dit réécriture. Alors moi je ne suis pas président d’un pays, mais l’objectif c’est qu’un dirigeant ait un devoir de réécriture de modèle. C’est-à-dire que si maintenant on rentre dans l’ère de la rareté, et de la sobriété, il faut bien penser différemment. Il faut que tous les modèles soient réécrits. Là on est assis sur un modèle financier qui a cinquante ans, qui porte sur l’abondance. Si à un moment donné, il n’y a pas une coalition qui dit stop, il faut penser, repenser le modèle, et la manière dont on compense toute la chaîne managériale, les investisseurs et cetera, et bien on n’y arrivera pas… Et c’est Don’t look up.
RM : Vous insistez sur l’importance d’un modèle convergeant.
CG : Il faut des bâtisseurs. Les patrons, mais aussi et peut-être surtout les académiques. Les profs doivent bouger. Ils sont toujours sur des ouvrages d’il y a quinze, vingt ans. Ils rajoutent des chapitres, mais il ne faut pas rajouter des chapitres, il faut réécrire des chapitres. C’est ça, l’enjeu. Quand on a présenté le modèle à HEC, ils ont sauté dessus parce qu’ils se sont dit « mince, en fait, on est autant silotés que les entreprises ».
RM : La transition passe en grande partie par l’éducation.
CG : Par l’université mais pas seulement. Quand HEC me dit que je dois venir former des étudiants, d’accord, mais les étudiants ne seront pas à des postes de dirigeants avant trente, quarante ans. Il faut bien qu’on forme les dirigeants aujourd’hui. Oui, c’est un problème d’éducation au sens large.
RM : Est-ce qu’il faut aussi aller parler à Bercy ?
CG : Oui, j’ai eu des échanges avec Bercy sur la base du livre. Les politiques ont beaucoup réagi par rapport au livre.
RM : J’imagine oui, parce que ce sont des solutions concrètes, et ce que j’ai oublié de dire, avec des effets immédiats.
CG : Et parce que ce livre a un souffle nouveau. J’ai eu beaucoup de retours. Au départ, c’était une méthode, et qui tournait depuis cinq ans. Comme je suis un intuitif, je me suis dit que j’allais écrire, distribuer le modèle à mes managers, comme ça ils n’auront plus d’excuses. Un cabinet américain voulait nous piquer les idées. Mais je voulais que l’idée soit disponible à chacun. C’est un partage d’expérience, rien de plus. Donc le bouquin est sorti au Cherche Midi. Il sort aussi aux États-Unis. Les Américains sont très friands de ça. Notamment parce que chez eux, il y a un front anti-ESG, anti-indicateurs européens, la taxonomie, la CSRD et cetera… Vous savez les américains sont très pragmatiques, c’est comme New-York, c’est carré, c’est simple. Donc ils cherchent des voies qui ne mettent pas en péril le profit. Le risque c’est qu’en période de récession, tout ce qu’on a fait sur l’environnement soit un non-sujet maintenant. Ça ne règle pas du tout le problème du système. Mais à l’échelle de l’entreprise, au moins c’est pragmatique, parce qu’on n’oppose pas profit, environnement, social, et on fait en sorte que ça converge.
RM : Et ça ne vous dirait pas de faire de la politique ?
CG : Ah non. On me l’a souvent proposé, mais non. Et puis, ma femme me l’a interdit.